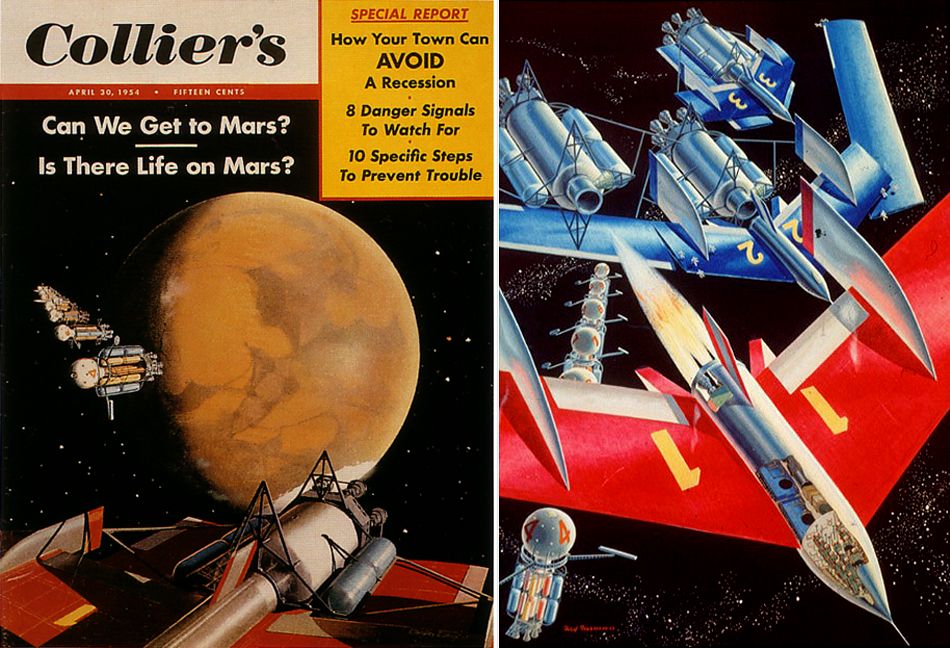Une fois cette comptabilité effectuée (voir
Mise à Jour), nous pouvons en venir –
sans bien entendu prétendre à l’exhaustivité – aux faits marquants de cette
année (voir également, pour les curieux, le
flop
et le
top
de l’année). Ils ne sont pas tous estivaux !
De fait, la fin de la
navette
spatiale, de même que les
accidents
russes de l’été dernier et l’incertitude qui en a résulté par rapport à la
desserte de l’ISS, ont déjà fait l’objet de précédentes séries de billets. Qui
plus est, maintenant que ces inquiétudes-là se sont évaporées alors que deux
nouveaux équipages internationaux ont déjà fait route vers l’ISS, l’année 2011
peut être analysée avec plus de sérénité.
Avec le recul, c'est-à-dire en essayant d’embrasser l’année
dans son intégralité, le grand angle devient alors plus facile à saisir.
Rappelons en effet que 2011 a commencé sous le signe de la
nostalgie. Comme je vous en avais fait part il y a
quelques
mois et aussi plus récemment, nous avons fêté cette année un triple anniversaire. 1) Russe tout
d’abord, avec les 50 ans du premier homme envoyé dans l’espace. 2) Américain
ensuite, avec le cinquantenaire du discours de
Kennedy
et le début du programme
Apollo qui a conduit 12 astronautes à marcher sur la
Lune. 3) Sans oublier, Français enfin, soit l’anniversaire des 50 ans du
Centre
national d’études spatiales (CNES) dont vous pouvez encore suivre le
déroulement des festivités sur le
site
internet et sur twitter
#LeCNESa50ans.
Or comme lors de chaque anniversaire, l’heure est certes aux
célébrations, mais également aux interrogations. Et elles sont
nombreuses ! C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il convient à mon
avis d’analyser les événements de cet été, plus quelques autres qui ont marqué
cette année.
1) Ainsi, la navette spatiale vieille de 30 ans et tirant sa
révérence, pour symbolique que cela puisse paraître, ne devient dans le
contexte plus global de la politique spatiale américaine qu’un élément parmi
d’autres. En effet, le nouveau programme spatial défini par l’administration
Obama cherche à implanter une double rupture :
- Technologique, imaginer les nouveaux modèles sur lesquels créer
le nouvel âge de l’aérospatial. Cela se traduit par la recherche de nouvelles
technologies et l’investissement massif dans la capacité de vol routinier en
direction de l’orbite basse (LEO)
- Psychologique, penser l’innovation plutôt que la simple
répétition. Cela se traduit par la remise en cause de l’évidence géographique
(la nouvelle frontière spatiale) au profit de la LEO via l’essor
de l’espace dit commercial, sans oublier non plus l’abandon – au moins partiel
– du vieux rêve d’un retour sur la
Lune
pour l’étape suivante : Mars.
- Dernier exemple significatif en date, la création de la
nouvelle entreprise spatiale privée baptisée
Stratolaunch
Systems. Savant mélange entre le lanceur Falcon 9 (le lanceur de
SpaceX) et le WhiteKnightTwo (l’avion
porteur utilisé par
Virgin Galactic),
le projet associant plusieurs entreprises spatiales a pour ambition de lancer
d’ici 2016 une fusée depuis un énorme avion porteur 10 km au dessus du sol. A
l’origine de cette initiative, quelques grands noms : Paul Allen,
co-fondateur de Microsoft, Burt Rutan, fondateur de
Scaled Composites et Mike Griffin, ancien administrateur de la
NASA.
2) Du côté russe, les interrogations sont d’autant plus
fortes que la parité avec l’ancien ennemi américain semblait avoir été atteinte
avec la fin de la navette spatiale. Pourtant les bourdes n’ont cessé de
s’accumuler depuis décembre 2010. A la perte de satellites et à l’explosion
d’un vaisseau
Progress, s’est en effet ajouté l’
abandon
du programme d’exploration martienne
Phobos-Grunt qui n’a pas réussi à quitter
l’orbite terrestre et dont la sonde s’est finalement désintégrée dans l’atmosphère terrestre.
- Cela explique le ton peu amène employé par le
président
Medvedev à l’égard des responsables du spatial russe. Plus largement, cela
montre aussi la difficulté qu’éprouve aujourd’hui le secteur spatial russe, fortement
malmené durant les années 1990, face aux velléités de changements et à la
nécessité d’une modernisation. De fait, malgré quelques poches de qualité qui
résistent, la crise des années 1990 est très loin d’être résorbée alors que le
déclin scientifique de la Russie se poursuit comme l’expliquait encore très
récemment le
Washington
Post.
- Reste la fusée Soyouz qui, entre autres Ariane et
prochains tirs Vega, permet à
Arianespace
de conclure l’année sur un bilan compétitif très satisfaisant avec un carnet de
commandes dépassant les 4 milliards et demi d’euros.
Pour cause,
passé
du froid sibérien aux tropiques, le Soyouz a encore démontré sa grande
fiabilité le 16 décembre dernier en procédant au
lancement,
depuis Kourou, de cinq satellites militaires français et un satellite chilien. Si
les quatre petits satellites
ELISA (
Electronic Intelligence Satellite) permettront
à la France de tester une capacité d’écoute électromagnétique (ROEM) partagée
uniquement par les Etats-Unis, la Russie et la Chine,
Pleiades 1 renforcera
quant à lui nos capacités d’observation en fournissant des images d’une très
grande résolution (voir les premières images
ici).
Rappelons en outre que le premier Soyouz avait mis en orbite deux
satellites de la constellation européenne Galileo.
3) Mais s’il y a interrogation, c’est aussi parce que 2011
illustre, peut-être plus que 2003, la montée en puissance du spatial chinois.
- Non seulement la Chine est parvenu cette année à mettre
en orbite un petit laboratoire, mais elle a aussi réussi à obtenir la capacité de
rendez-vous orbital comme la
manœuvre
conduite entre
Tiangong-1 et
Shenzhou-8 peut en témoigner. Désormais,
la Chine pourra poursuivre son programme spatial sur une plus grande échelle. D’ores
et déjà, deux missions Shenzhou sont annoncées pour début 2012.
- Enfin, contrairement à ce que j’avais laissé entendre dans
mon précédent billet introductif (voir
MAJ), la Chine a finalement dépassé pour la
première fois les Etats-Unis en termes de lancements avec 19 tirs
effectués cette année (un échec seulement) contre 18 pour les Américains (un
échec aussi). La mise en orbite surprise du satellite d’observation
ZY
1C hier a en effet bousculé mes conclusions peut-être trop hâtives. A noter
que l’an passé, les Etats-Unis et la Chine avaient tous les deux procédé à 15
lancements.
4) Alors 2011 année charnière ? Pari américain,
modernisation russe, affirmation européenne et accélération chinoise :
tout y est, bien qu’à des degrés différents et selon des efforts variables. Ainsi,
les relations spatiales sino-américaines seront celles qui détermineront
certainement tout le reste comme le montre ce récent article de la revue
Nature.
Elles s’inscriront de fait dans un ensemble plus vaste traduisant l’ascension
militaire chinoise et le déclin relatif américain…
MAJ : La série noire qui frappe le spatial russe depuis bientôt un an se poursuit. Ce matin, un lanceur Soyouz-2 n’est pas parvenu à mettre en orbite le cinquième satellite de communication militaire
Meridian. Reste à savoir comment va réagir
Globalstar dont plusieurs satellites doivent être lancés le 28 décembre prochain... Pour plus d’info, voir
LeMonde.fr et
BBCNews.