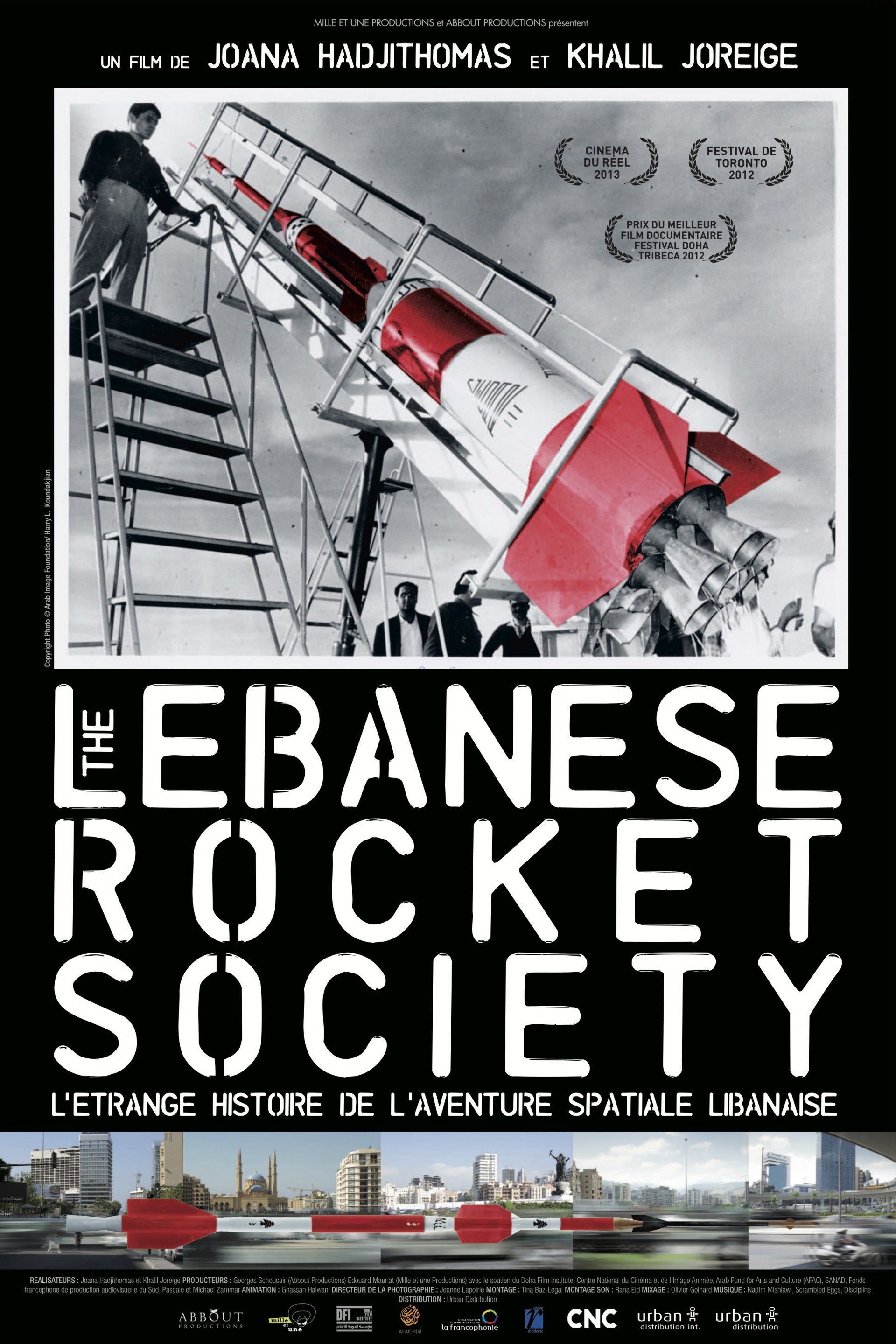Cette opinion tranchée n’est guère nouvelle alors que régulièrement apparaît dans les médias l’idée selon laquelle le vol spatial habité est un mythe dispendieux et inutile qui ne perdure que grâce au lobby spatial constitué des industriels et des agences elles-mêmes. La fin du programme Space Shuttle aux Etats-Unis a ainsi été l’occasion pour certains de rappeler que le rêve spatial gaspillait d’immenses ressources et rapportait finalement bien peu. Les véritables explorateurs du cosmos sont physiciens, astronomes, cosmologistes entend-on. Ceux là n’ont pas besoin d’une station spatiale à 100 milliards ni de l’infrastructure immense requise pour faire voler des hommes dans l’espace. Et ceux là seuls font véritablement progresser les connaissances. Alors, les astronautes ne seraient-ils que les « conquérants de l’inutile » pour reprendre la formule admirablement concise utilisée par Serge Brunier – journaliste pour Sciences & Vie, spécialisé dans l’astronomie – dans son ouvrage archétype de 2006 intitulé Impasse de l’espace : A quoi servent les astronautes ?

William Shakespeare, The Merchant of Venice
L’approche adoptée par Brunier fonctionne sur plusieurs niveaux. Elle prend d’abord pour appui le péché originel que l’homme aurait commis en voulant accéder aux cieux, qu’elle file ensuite du premier chapitre jusqu’à la conclusion. Fruit de l’Allemagne nazie et de sa soif destructrice de puissance, le rêve spatial de l’humanité ferait ainsi tout comme les Atrides l’objet d’une malédiction qui de génération en génération se perpétuerait. Aussi Wernher von Braun à l’origine du programme V2 commandé par Hitler, par ailleurs officier SS pour qui la main d’œuvre gratuite des prisonniers du camp de Peenemünde était une aubaine, est-il passé à l’Ouest après la guerre et a participé de près à cette impasse à 25,4 milliards de dollars (151 milliards constants pour l’année 2010) que fut l’apothéose Apollo. De même la course au prestige qui a caractérisé la guerre froide trouve-t-elle des réminiscences aujourd’hui en cristallisant espoirs crédules et inquiétudes feintes en Europe et aux Etats-Unis autour du programme spatial chinois pour lequel l’Empire du Milieu, pays encore pauvre par bien des aspects, dépense « sans sourciller des milliards d’euros pour singer l’Amérique et l’Union soviétique des années 1950 » (p. 206).
Elle met ensuite l’accent sur l’immaturité de nos sociétés qui, trop aisément dupées par leur soif de prestige, confrontent leur ego dans l’espace sans sens de la mesure aucun. Pour l’auteur, le caractère persistant du vol habité malgré les décennies est le signe que l’humanité refuse de grandir. Il est un véritable anachronisme qui témoigne à la fois d’une incapacité d’apprendre et d’une extravagance criminelle. Non seulement les astronautes sont encore et toujours les « conquérants de l’inutile » qu’ils poursuivent assidument depuis plus d’un demi-siècle, mais leurs efforts gratuits sont abjects alors que « A elles toutes, la Chine, la Russie, l’Europe et l’Amérique du Nord engloutissent une quinzaine de milliards d’euros par an dans les vols habités, soit l’équivalent du PNB de l’Albanie, de la Namibie ou de Madagascar » (p. 197). On trouve par conséquent régulièrement dans l’ouvrage la métaphore du « bac à sable » : le vol spatial est présenté comme un jeu, un « enfantillage » (p. 283), que se disputent entre elles les grandes puissances dans leur souci de paraître, paradoxalement, « comme une grande » (p. 207). Et Brunier d’indiquer qu’il est « temps de sonner la fin de la récréation » (p. 283) et d’abandonner nos fantasmes de jeunesse de colonisation galactique que les auteurs de science fiction sont coupables d’avoir follement semés en nous (p. 20-21), tout comme les nourrices étaient selon Descartes à l’origine des fausses évidences que les hommes une fois arrivés à l’âge adulte devaient désapprendre pour voir objectivement le monde.
Malgré ces quelque 300 pages, on ne saurait trouver de livre plus lapidaire dans la thèse défendue tant rien n’est épargné aux partisans des vols habités pour qui l’espace est surtout constitué par la « part du rêve ». Il ne s’agit pas ici d’une promenade de santé dont on goûte les charmes paisibles en folâtrant le brin d’herbe dans la bouche, mais d’une attaque dont la violence pourra paraître disproportionnée par rapport à la proie facile bien qu’au demeurant coupable. Certes cette Impasse de l’espace présente des arguments forts que l’on ne saurait balayer d’un simple revers de main alors que les enjeux dessinent plusieurs dizaines de chiffres avant la virgule. Pourtant l’intérêt du livre est limité par l’approche choisie, la forme prenant en quelque sorte le dessus sur le fond. Au fond, ce n’est pas le K.O qui est recherché, mais la mise à mort. L’auteur ne veut pas persuader ni inciter au débat, il veut polémiquer. Et de fait, jamais il n’indique vouloir convertir. En ridiculisant l’espace habité – ses croyances absurdes, son clergé au mieux sincère mais « idiot utile », au pire hypocrite et cynique et donc égoïste, son rituel absurde, son histoire reconstruite et ses saints mythifiés –, c’est au reste de la population qu’il s’adresse : caute, vigilance ! Dès lors, inutile de chercher dans ce livre pamphlétaire traces véritables d’arguments ou de preuves ; on n’y trouvera que de l’indignation et une vérité unique, exclusive. Avec de tels effets, Serge Brunier a pu gagner en visibilité et en audience ce qu’il a perdu en profondeur et subtilité. Il est néanmoins dommage de ne pas traiter un tel sujet avec le respect et l’intelligence qu’il lui est dû et participer ce faisant à l’échange serein des idées. Cela semblera d’autant plus vrai que le résultat est à mon sens contreproductif. A force d’enfoncer des portes ouvertes – mouvement dans lequel la virulence du propos et le verbe ironique se diluent trop aisément – et de semer son chemin de contorsions, le moindre des paradoxes de l’ouvrage est finalement celui d’avoir choisi apparemment le pamphlet ou la polémique pour s’exprimer, tout en optant curieusement pour une forme non pas courte et élancée comme le voudrait le genre, mais laborieuse et répétitive.
Certains trouveront cette Impasse de l’espace « bien renseigné[e] ». Prétendre toutefois que le vol habité est profondément inutile du point de vue de la science, en plus d’être ruineux, donc irrationnelle, est non seulement formuler une évidence maladroite et un peu courte, c’est aussi selon moi avouer le peu d’attention que l’on accorde à la véritable question : pourquoi l’humanité continue-t-elle, « absurdement » me dois-je d’ajouter, à vouloir poursuivre le rêve insensé d’Icare ? Plus particulièrement, pourquoi de plus en plus de nations succombent-elles au vice spatial et envoient cosmonautes, astronautes, spationautes et autres taïkonautes visiter l’orbite terrestre ? Ce faisant, Serge Brunier est coupable selon moi d’un péché relativement répandu parmi les spécialistes : le réductionnisme. Dès lors, que l’on s’accorde ou non sur le caractère inutile de la conquête de l’espace, une mise en contexte au moins partielle demeure absolument nécessaire.

Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances, ils n’ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas ; ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir...
Marcel Proust, Du côté de chez Swann
Parler de prestige – mot magique s’il en est – pour que, à peine avancée, l’explication soit aussitôt balayée sans autre forme de procès sous couvert d’« irrationalité », d’« immaturité » et de « gratuité » est à mon sens par trop réducteur. Face à une vision unidimensionnelle de la conquête de l’espace, la moindre des choses aurait été de procéder à un minimum d’effort de définition.
Rappelons ainsi que pour le politiste classique, qu’il s’appelle Hobbes ou Rousseau, la poursuite du prestige est un des éléments de différence permettant de distinguer l’homme de la bête et du primitif présocial. S’ensuit, si l’on en croit cette tradition du prestige comme « fin en soi », plusieurs caractéristiques : 1) Le prestige est un bien relatif– l’appropriation d’une position par l’un n’étant jamais absolue, mais toujours menacée par l’ambition des autres – pour lequel les hommes évoluant en société s’affronteront éternellement. 2) Le prestige est irrationnel dans le sens où la quête de celui-ci ne donne pas toujours des résultats matériels optimaux. Mais s’il est indéniable que du point de vue matériel rationnel le bien-être physique d’un individu est prioritaire, il n’est pas rare de voir l’un donner jusqu’à sa vie pour poursuivre un objectif a priori illogique. De ce point de vue, parler d’irrationalité, c’est assumer une certaine normativité. Ajoutons sur ce sujet que l’irrationalité supposée est aussi un doigt accusateur pointé sur la « non-proportionnalité » des fins et des moyens de la poursuite. Un événement apparemment vain pourra ainsi déclencher tout une spirale d’actions et d’efforts coûteux sans tenir compte des conséquences ou de la probabilité de réussite. 3) Enfin, essentielle dans le cas présent, est l’idée que la poursuite du prestige est socialement et historiquement conditionnée. Pour cette raison, le membre d’une société particulière pourra effectivement trouver absurde la compétition et le prix qu’une autre aura fixé pour un bien spécifique. La cérémonie bien connue en anthropologie du potlatch, où l’on voit chaque partie faire étalage de dons/contre-dons de plus en plus ruineux dans l’espoir d’être perçu comme le plus prodigue, est (au moins en partie) incompréhensible aujourd’hui dans notre société. Cette référence me semble d’autant plus appropriée que la course à l’espace a souvent été comparée à cette dynamique de dépense pure où la légitimité interne et externe des deux Grands était fonction de la qualité et de la quantité des contributions que chacun apportait à l’exploration spatiale (les fameuses « premières ») y compris en ruinant son économie.
Dès lors, loin de simplement « inhiber la recherche et le développement » ou apparaître comme « le frein le plus sûr, le plus efficace, à l’exploration réelle de l’espace » (p. 21), la présence des astronautes en orbite, aka « envoyés de l’humanité », impose de changer de focus. Elle est ainsi à mes yeux la plus belle preuve que l’espace puisse donner pour convaincre qu’une société internationale existe. Pour cause, l’espace en tant qu’« objet de prestige » me paraît indiquer une compréhension mutuelle entre les Etats aujourd’hui sur ce qui est ou non un symbole de supériorité ou d’éminence. Rien de bien surprenant d’une certaine manière si l’on considère la mondialisation et la fusion de plusieurs sociétés divergentes au sein d’une seule et même société globale. Impasse ou non, le caractère persistant du vol habité, loin d’être synonyme d’immaturité, est à la fois le symptôme et le résultat d’une société développée, sophistiquée, intégrée et globale. Il est aussi, et c’est l’envers de la médaille, le signe d’une société compétitive.
Reste que, du point de vue strictement spatial, à en juger par exemple par la Station spatiale internationale – décriée pour son prix exorbitant et son inutilité du point de vue scientifique principalement parce qu’elle a été conçue pour être habitée et disposée sur une certaine orbite peu pertinente pour les expériences en microgravité –, la poursuite de la reconnaissance internationale peut pousser à la coopération. On pourra bien entendu critiquer cette position (pour un avis plus sincère, préférer par exemple les ouvrages d’André Lebeau dont j’ai récemment annoncé la disparition) ; elle n’est d’ailleurs très logiquement pas exempte de processus d’exclusion de la famille des grandes puissances spatiales. Néanmoins, l’on s’accordera tout de même pour dire que, au-delà du progrès de la connaissance, la conquête de l’espace est aussi l’occasion de l’apprentissage d’un certain vivre-ensemble.

Images : Icare et Dédale, par Charles Paul Landon (1799) et Cmdr Hadfield/Spaceship command