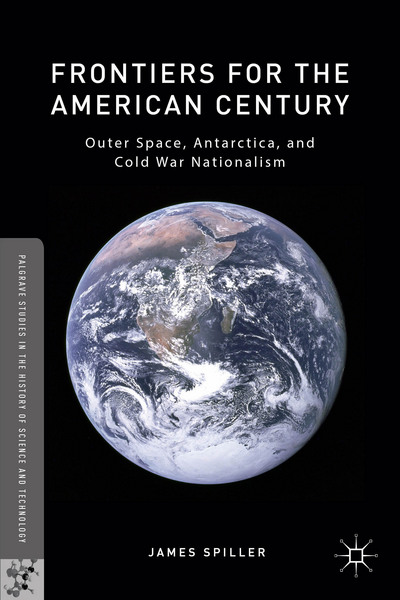
Pour Spiller, l’article éponyme publié en 1941 dans le
magazine Time est en effet fondateur, et cela à deux titres. La première raison est qu’il donne au pays une nouvelle
conception de l’exception américaine, en plus de celle inspirée par l’idée de
l’Amérique comme Terre promise qui guide sa démarche depuis 1776 notamment face
aux querelles et aux ambitions du Vieux Continent. Des décennies après les
premières tentatives d’internationalisme et les expériences issues de la grande
dépression et du début de la Seconde Guerre mondiale, la notion de
« Siècle américain » doit selon son inspirateur mettre en avant
l’idée de l’Amérique comme Etat croisé qui cherche non plus à se préserver du
monde mais à le transformer à son image. La seconde raison est plus implicite
et part du constat qu’aucun projet hégémonique n’est durable sans l’assentiment
et le soutien actif des populations qu’il vise à l’étranger mais aussi et
surtout au niveau domestique. Pour les contemporains, en particulier après
Spoutnik, il apparaît rapidement que la vision offerte par Luce ne pourra
devenir réalité que si elle s’appuie sur un discours mobilisateur à même de
faire coïncider la réalité de la puissance avec sa perception, autrement dit, une
« national identity oriented to
internationalism with the power to move Americans ».
Le cosmos et le continent blanc ont accédé au rang de
« frontières du Siècle américain » dans ce contexte. Non seulement le
motif des frontières de l’espace et de l’Antarctique est gratifiant et
politiquement utile face à la compétition émergente avec l’Union soviétique
dans les domaines de la science et de la technique, mais il s’avère également
politiquement efficace en cela qu’il résonne avec deux versions du mythe de la
frontière alors au sommet de leur popularité aux Etats-Unis. 1) L’histoire du
progrès national et de la vitalité démocratique racontée par l’historien Frederick
Jackson Turner met en effet en avant l’optimisme de l’Amérique d’après-guerre,
alors plus que jamais convaincue que l’esprit pionnier qui la caractérise sera
gage d’une encore plus grande prospérité et liberté. 2) Il en est de même de
l’interprétation privilégiée par le président Theodore Roosevelt qui nourrit
l’espoir que le processus de réjuvénation martiale, raciale et sociale sans fin permis par la conquête de la frontière américaine inspirera ses concitoyens et les mobilisera
en faveur de projets nationaux grandioses.
Ces deux conceptions servent à la fois de cadre théorique et
de fil directeur à l’ouvrage. Quoique leur exploration constitue un apport
bienvenu à la littérature
déjà bien fournie sur le mythe de la frontière et son utilisation en
particulier dans le contexte
spatial, là n’est pas l’intérêt premier de Frontiers for the American Century. Ce que Spiller propose n’est
pas seulement une étude historique sur les liens étroits unissant culture et
science et technologie et programmes publics de R&D, il s’agit plus
largement d’une analyse comparative expliquant de manière dynamique comment le
« paradigme nationaliste » de la frontière évolue au gré des
changements culturels et internationaux.
Le fait de parler de paradigme n’est évidemment pas
innocent. Pour l’auteur, qui s’inspire des travaux de Thomas Kuhn, il existe
des similarités entre la façon dont les « nationalistes » regardent la nation à
laquelle ils appartiennent et la manière avec laquelle les scientifiques
traitent les phénomènes naturels. Il y a tout d’abord une phase de « science
normale » au cours de laquelle les individus internalisent un certain
nombre de lois et tendent à négliger les anomalies susceptibles de les
infirmer. Vient ensuite une phase d’ajustement au cours de laquelle de
nouvelles hypothèses sont testées et où nous voyons apparaître, si d’aventure celles-ci
vont à l’encontre du paradigme existant, un nouveau paradigme qui vient
remplacer définitivement l’ancien, en attendant d’être démenti à son tour. Tel
a été le cas pour l’espace et l’Antarctique qui, tous les deux, bien que de
façon séparée et désaccordée, ont fait l’objet d’une « révolution
paradigmatique ». Lorsque l’esprit de conquête qui caractérise la
frontière turnerienne (= pour les ressources qu’elle renferme et le progrès
socio-économique qu’elle promet) et rooseveltienne (= pour le souffle
revigorant qu’elle offre et le renouveau social qu’elle permet) est passé de
mode, une nouvelle compréhension culturelle a émergé pour le continent austral
centré sur sa préservation face au changement climatique et le rôle d’intendance
(stewardship) auquel
l’Amérique pouvait plus efficacement prétendre dans sa quête de
leadership. Le motif de la frontière s’est montré plus résistant dans le cas du
cosmos mais a fini lui aussi par succomber comme en témoigne le malaise qui frappe la NASA et le vol habité en particulier depuis la fin de
la Guerre froide. Mais il n’a pour autant disparu, croit savoir l’auteur.
Car tant que les Etats-Unis chercheront y compris de manière intermittente
à jouer le rôle du shérif, tout est au
plus sera-t-il dormant pour citer un ouvrage publié dans les années 1990.
Frontiers for the
American Century s’inscrit ainsi à la suite d’un grand nombre de travaux récents
d’auteurs anglo-saxons, dont certains ont d’ailleurs déjà
été commentés
sur ce blog. On trouvera ceci dit l’exercice plus convainquant que chez
beaucoup d’entre eux. Le mérite en revient principalement à la décision louable
d’arrêter de tourner autour du pot. La distinction plus médiatique que réellement
scientifique entre soft et hard power a beau demeurer, on y parle enfin directement de puissance et d’influence et de son indicateur
premier qui est la quête du prestige pour lui-même. Comme cela est souvent le
cas avec ce type d’écrits, la conclusion arrive toutefois trop tôt et
l’on est une fois encore laissé sur notre faim en l’absence d’une analyse
couvrant également la période de l’après-Guerre froide au lieu de l’évacuer en
quelques paragraphes de conclusion maladroits. Celle-ci demeure donc à ce stade
terra incognita et frontière
indépassable.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire